Cuisson à la vapeur douce
 Le type de cuisson des aliments fait beaucoup débat aujourd’hui (à la vapeur, au four…). Tous les articles de journaux ne sont pas écrits en s’appuyant sur des vérités scientifiques. Faisons un point rapide sur la question.
Le type de cuisson des aliments fait beaucoup débat aujourd’hui (à la vapeur, au four…). Tous les articles de journaux ne sont pas écrits en s’appuyant sur des vérités scientifiques. Faisons un point rapide sur la question.
Pour cuire dans des conditions optimales, l’aliment doit garder sa texture et sa tenue, ses vitamines, minéraux et oligo-éléments. Il est préférable d’éviter de dépasser le seuil de 95°C à cœur de l’aliment. La cuisson doit détruire les enzymes, les bactéries, éliminer les produits toxiques de surface comme les pesticides, tout en préservant la texture, les éléments nutritifs et le goût. Les effets ne sont pas du tout les mêmes selon qu’on utilise l’eau, la vapeur, l’ huile, ou le four. D’un point de vue scientifique, le facteur temps et le taux d’humidité lors de la cuisson est plus important que le facteur température.
Selon le professeur Marc Henry, dès lors qu’on déracine un aliment naturel ou qu’on le cueille, les enzymes qu’il contient et qui lui permettaient de mûrir, commencent à le détruire. C’est un processus naturel de destruction. « Les enzymes n’ont en elles-mêmes aucun intérêt nutritif et sont même plutôt nuisibles, car ce sont elles qui favorisent la perte des qualités nutritives lors du stockage en fonction des conditions d’humidité ou d’oxygénation. Par exemple, l’acide ascorbique oxydase AAO est responsable de la transformation de l’acide ascorbique en acide déhydroascorbique, DHAA lorsqu’on monte en température. Si on place l’aliment directement à une température qui permette de le saisir, il y aura plus de vitamine C après cuisson, car on inactive l’AAO. A noter qu’en l’absence d’AAO, la vitamine C est relativement stable thermiquement et ne se dégrade pas avant 220°C. Ceci est valable pour les autres vitamines. Ce n’est donc pas la température en elle-même qui entraîne une dégradation des vitamines, mais plutôt l’action conjuguée des enzymes, de l’augmentation progressive de la température, de la quantité d’oxygène disponible et du taux important d’humidité. »
Concernant la cuisson à la chaleur intense, les grillades au barbecue, notamment, entraînent le brunissement de l’aliment et la formation de molécules toxiques comme la réaction de Maillard, qui est connue comme cancérigène impliquant graisses et sucres. Quand on va plus loin encore dans le processus de cuisson, on se trouve des goudrons comme les benzopyrènes et les méthylcholantrènes qui, associés, sont fortement cancérigènes. On évitera donc ce type de cuisson régulièrement. On peut néanmoins se faire plaisir et s’autoriser une grillade occasionnelle l’été.
Quant à la cuisson au four, on préférera les fours à chaleur tournante qui permettent une meilleure répartition de la chaleur. Cependant, au four, les aliments doivent cuire plus longtemps pour être cuits suffisamment et les éléments nutritifs vont se dégrader.
La cuisson à la poele sera aussi très dépendante de la chaleur générée. En général, on cherche à saisir l’aliment donc on se retrouve avec les méfaits de la cuisson à la chaleur intense, décrits ci-dessus.
La cuisson à la casserole et à l’eau bouillante reste un bon mode de cuisson. Il faut veiller à plonger les aliments que lorsque l’eau bout à gros bouillons et pas avant. Grâce à cette règle les enzymes contenues dans l’aliment perdent leur activité de destruction et l’aliment est mieux préservé. Si possible on découpera les aliments en petits morceaux pour que la cuisson soit plus homogène.
La cuisson à la vapeur reste le meilleur moyen de cuire les aliments. Mais pas n’importe quelle cuisson à la vapeur. Il faut cuisiner à la vapeur douce, sans pression. En effet, lors d’une cuisson à la vapeur sous pression, la vapeur monte progressivement passant du froid à la température où les enzymes sont activées et détruisent les principes nutritifs de l’aliment. La température peut ensuite dépasser 140° ce qui détériore, selon la dureté de la fibre, la structure du produit. Le temps que la soupape se mette en rotation et refroidisse légèrement, les enzymes et les vitamines hydrosolubles sont détruites. La cuisson à la vapeur sous pression n’est donc pas optimale. Un appareil de cuisson à la vapeur douce est donc un équipement à posséder dans sa cuisine. Il cuit ainsi les aliments sans les dessécher et conserve tous leurs éléments nutritifs. dans un appareil comme le vitaliseur, les mauvaises graisses, toxines et pesticides sont éliminés en tombant dans l’eau de cuisson.
Restons vigilant également sur la qualité des aliments que l’on achète. Bien entendu, préférer des aliments locaux bio car la cuisson ne permet pas de détruire les métaux lourds en provenance de la contamination environnementale.
 On peut lire dans la presse ou entendre sur les ondes beaucoup de choses contradictoires sur les produits laitiers. Vous vous souvenez probablement du slogan « les produits laitiers sont nos amis pour la vie » ? Selon les sources officielles et l’industrie agroalimentaire, ils seraient très favorables à notre bon développement et à notre santé. Pourtant, la plupart des adultes ne digèrent pas le lait et il existe de nombreuses régions du monde dans lesquelles les habitants ne consomment pas du tout de lait, ce qui ne les empêche pas de demeurer en excellent santé et de vivre plus longtemps que nous. Le journaliste Thierry Souccard dresse un bilan peu flatteur de cette surconsommation de lait dans son ouvrage « Lait, mensonges et propagande ». Préfacé par le Pr. Henri Joyeux, ce livre dénonce les lobbies et les contrevérités avancées par l’industrie laitières depuis de nombreuses années. Il présente les réels effets du lait sur la santé, études scientifiques à l’appui. Il remonte aux faits historiques (Angleterre, France, USA…) qui ont contribués à promouvoir cette industrie, comme la distribution au cours de la première guerre mondiale de produits laitiers en conserves pour les soldats ou la circulaire de Pierre Mendès-France qui a institué la distribution de lait et de sucre dans les établissements scolaire à partir du premier janvier 1955. Il retrace ensuite la toute-puissance du marketing, venue alors renforcer l’effet de ces campagnes. Les industriels savent qu’instaurer des habitudes alimentaires à des enfants est hautement profitable puisqu’elles perdureront en général tout au long de leur vie d’adulte.
On peut lire dans la presse ou entendre sur les ondes beaucoup de choses contradictoires sur les produits laitiers. Vous vous souvenez probablement du slogan « les produits laitiers sont nos amis pour la vie » ? Selon les sources officielles et l’industrie agroalimentaire, ils seraient très favorables à notre bon développement et à notre santé. Pourtant, la plupart des adultes ne digèrent pas le lait et il existe de nombreuses régions du monde dans lesquelles les habitants ne consomment pas du tout de lait, ce qui ne les empêche pas de demeurer en excellent santé et de vivre plus longtemps que nous. Le journaliste Thierry Souccard dresse un bilan peu flatteur de cette surconsommation de lait dans son ouvrage « Lait, mensonges et propagande ». Préfacé par le Pr. Henri Joyeux, ce livre dénonce les lobbies et les contrevérités avancées par l’industrie laitières depuis de nombreuses années. Il présente les réels effets du lait sur la santé, études scientifiques à l’appui. Il remonte aux faits historiques (Angleterre, France, USA…) qui ont contribués à promouvoir cette industrie, comme la distribution au cours de la première guerre mondiale de produits laitiers en conserves pour les soldats ou la circulaire de Pierre Mendès-France qui a institué la distribution de lait et de sucre dans les établissements scolaire à partir du premier janvier 1955. Il retrace ensuite la toute-puissance du marketing, venue alors renforcer l’effet de ces campagnes. Les industriels savent qu’instaurer des habitudes alimentaires à des enfants est hautement profitable puisqu’elles perdureront en général tout au long de leur vie d’adulte. A l’origine, des livres écrits par le Dr. Devi Nambudripad « Living Pain free with acupressure », « You can reprogram your brain to perfect health » et « Say goodbye to illness ». Devi Nambudripad est d’origine indienne et installée à présent aux Etats-Unis. Elle exerce la médecine, l’acupuncture, la chiropractie et la kinésiologie.
A l’origine, des livres écrits par le Dr. Devi Nambudripad « Living Pain free with acupressure », « You can reprogram your brain to perfect health » et « Say goodbye to illness ». Devi Nambudripad est d’origine indienne et installée à présent aux Etats-Unis. Elle exerce la médecine, l’acupuncture, la chiropractie et la kinésiologie.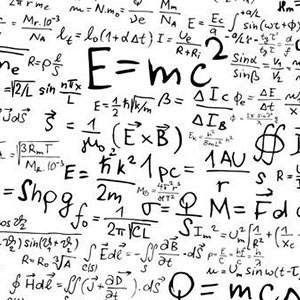
 Dans un article de la Physical Review du 23 octobre 2014, des chercheurs de l’Université de Californie et du Centre for Quantum Dynamics de l’Université Griffith remettent en cause les fondements de la mécanique quantique.
Dans un article de la Physical Review du 23 octobre 2014, des chercheurs de l’Université de Californie et du Centre for Quantum Dynamics de l’Université Griffith remettent en cause les fondements de la mécanique quantique. L’Assemblée nationale vient d’adopter la
L’Assemblée nationale vient d’adopter la